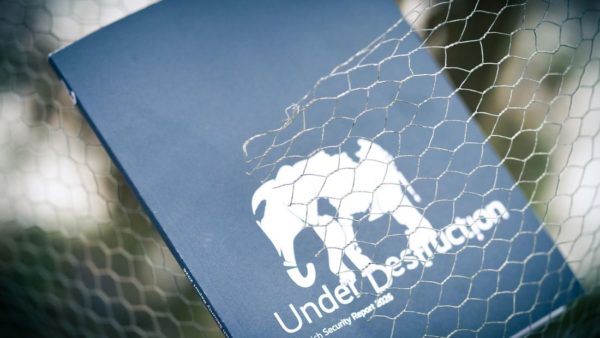Nul ne doute que l’Allemagne dispose d’un poids important et joue un rôle prépondérant au sein de l’Union européenne. Nul ne doute non plus que, dans ce pays, le Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), l’un des plus grands quotidiens nationaux, reflète souvent fidèlement l’état d’esprit des forces dirigeantes allemandes, notamment des milieux d’affaires.
Dès lors, lorsqu’un éditorialiste influent de ce journal rédige un réquisitoire au vitriol contre l’état actuel de l’UE (30/10/2025), il convient d’y prêter attention, d’autant que le FAZ n’a jusqu’à présent jamais caché son attachement à l’intégration européenne.
Nikolas Busse n’y va pas de main morte. Il affirme d’emblée : « les principaux piliers qui soutiennent la politique étrangère et la vision du monde de l’Europe ont été ébranlés en peu de temps, voire complètement détruits ».
Il cite en exemple la défense, la protection du climat, le libre échange, la mondialisation, le rôle de l’UE dans le monde. Et remet même en cause le fondement idéologique de l’intégration : « autrefois, on pensait que les Européens seraient plus forts s’ils agissaient ensemble ; aujourd’hui, ils se tirent mutuellement vers le bas ». Quel aveu !
L’auteur ne se contente pas de ce constat redoutable. Il ajoute perfidement que « le Premier ministre hongrois est actuellement plus écouté à Washington que la présidente de la Commission européenne ». Et en conclut, amer : « l’Europe n’est pas prise au sérieux dans le monde parce qu’il n’est pas nécessaire de la prendre au sérieux ».
Plus explosif encore, il ébauche une critique des dogmes officiels de ces dernières décennies en affirmant que « le déclin de l’Europe était inévitable ». En effet, note l’analyste, « après les guerres mondiales, les Européens ont perdu leur rôle de leader occidental au profit des États-Unis. L’essor industriel de l’Asie et les énormes transferts d’argent vers les pays producteurs de matières premières du Moyen-Orient, mais aussi vers la Russie, ont ensuite créé de nouveaux centres de pouvoir ».
Les griefs sont aussi actuels : la volonté d’ériger l’UE en « puissance normative capable d’exporter ses valeurs dans le reste du monde (…) s’est souvent retournée contre elle ». Exemples : « la tentative d’imposer la protection des enfants ou du climat à l’échelle mondiale a nui à l’économie européenne. La tentative de défendre le droit d’asile a poussé de nombreuses sociétés européennes aux limites de leurs capacités matérielles et culturelles »…
Toute cette analyse aboutit à une conclusion qui sonne comme un appel : « la solution ne réside pas dans le renforcement de l’UE » ; au contraire, celle-ci « a avant tout besoin d’États membres forts, tant sur le plan économique que militaire ». Et l’on se doute bien que l’auteur ne pense pas ici à Malte ou à la Lituanie, mais plutôt à son propre pays.
Il s’agirait d’une révolution copernicienne mettant en cause, à terme, l’existence même de l’UE
Plusieurs évolutions de fond ou ruptures peuvent expliquer cette prise de position du journaliste qui engage d’une certaine manière la rédaction du FAZ. Parmi celles-ci figure l’élargissement à treize pays d’Europe centrale en 2004 (puis en 2007 et 2013). Ces adhésions en masse avaient été particulièrement soutenues par Berlin, qui y voyait le renforcement de son arrière-cour économique et la confirmation de sa tutelle politique sur les nouveaux venus.
C’était l’époque où les chanceliers Kohl puis Schröder proclamaient : « l’unification allemande et l’unification européenne sont les deux faces d’une même médaille ». Deux décennies plus tard, le triomphe s’est transformé en cauchemar. Des « petits » pays de l’Est, qu’on espérait dociles, font preuve d’une dissidence sur nombre de dossiers, notamment (mais pas seulement) en politique étrangère où les décisions se prennent encore à l’unanimité.
C’est évidemment le cas de la Hongrie, suivie par la Slovaquie, et désormais probablement de la République tchèque. Ce fut le cas précédemment de la Pologne, et les choix de la Bulgarie restent très fragiles.
Surtout et plus généralement, une UE à vingt-sept (sans même évoquer les adhésions suivantes, plus aléatoires que jamais) est plus lourde et difficile à manœuvrer qu’un bloc de douze ou quinze membres. Les querelles deviennent permanentes. Les affrontements qui se dessinent sur le futur budget communautaire septennal devraient le confirmer.
Un deuxième facteur est mentionné explicitement par Nikolas Busse : « l’Europe est de plus en plus confrontée à des pays qui poursuivent sans scrupules leurs intérêts nationaux ». Parmi les exemples cités figurent la Chine, la Russie et les Etats-Unis. Ce dernier cas est évidemment le plus sensible. L’Oncle Sam a toujours considéré ses alliés comme des vassaux ; mais avec Donald Trump, les relations entre les deux rives de l’Atlantique ont été dépouillées de la vaseline idéologique – les « valeurs communes ». Restent donc les pures confrontations d’intérêt.
Dans ce contexte, la fidélité à Washington, qui reste un fondement génétique de l’UE, pourrait bien être vu à Berlin comme un handicap dès lors qu’il s’agira de défendre son bout de gras national. Par exemple, certains commencent déjà à réfléchir au jour d’après la guerre en Ukraine : il pourra être tentant pour certains grands groupes allemands, de renouer avec Moscou.
Enfin, troisième facteur (l’énumération n’est pas exhaustive) : le « rêve européen », qui n’a jamais enthousiasmé les foules, se heurte à une réticence croissante parmi les peuples, voire parfois à un rejet. Nikolas Busse signale du reste que l’ancien horizon censé faire vibrer les citoyens, à savoir construire « les Etats-Unis d’Europe », est irréaliste et obsolète – ce qu’on savait déjà, mais qui a le mérite d’être clairement affirmé.
Tout cela mis bout à bout est de nature à faire réfléchir les forces dominantes allemandes. Cela ne signifie nullement, évidemment, qu’on soit à la veille d’une sortie du pays de l’Union européenne. Du reste, des changements comme ceux que suggère l’éditorialiste sont des évolutions lentes.
Et il faut rappeler qu’il y a toujours eu, à Berlin, notamment depuis 1990, une certaine coexistence entre la tentation d’accélérer l’intégration européenne, vue comme un tremplin pour le pays, et celle de faire prévaloir une logique plus ouvertement nationale – les deux servant le même objectif de domination.
Mais l’article paru dans le FAZ pourrait bien être un jalon signalant que la seconde tentation pourrait désormais gagner du terrain. Il sera intéressant, dans les semaines et mois qui viennent, de surveiller l’émergence d’indices confortant cette hypothèse. Si tel était le cas, il s’agirait d’une véritable révolution copernicienne mettant en cause, à terme, jusqu’à l’existence même de l’UE.