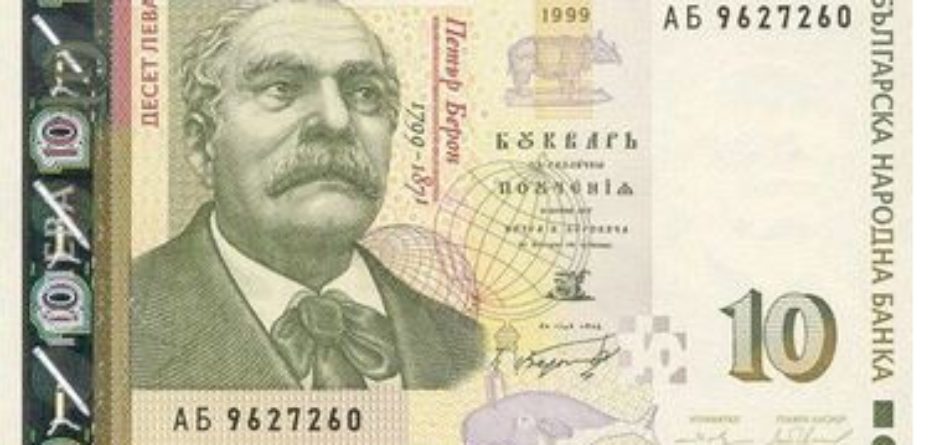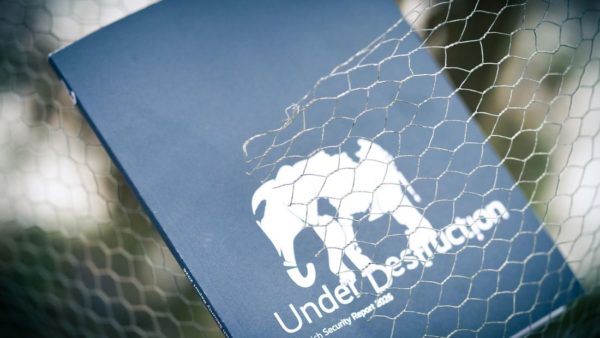Le 4 juin, la Commission européenne avait donné son feu vert. La Banque centrale européenne a pour sa part confirmé son aval dans la foulée. Et tout récemment, le 8 juillet, l’Ecofin (qui regroupe les ministres des finances de la zone euro), a définitivement validé la décision : le 1er janvier prochain, la Bulgarie abandonnera sa monnaie nationale – le lev (photo), créé en 1881 – au profit de la monnaie unique européenne.
Le seul interlocuteur qui n’ait pas été consulté est… le peuple bulgare lui-même. C’était sans doute plus prudent. La presse de Sofia s’est fait récemment l’écho de sondages qui n’étaient guère encourageants pour les partisans de l’intégration au sein de la zone euro. Selon ces enquêtes, 50% des citoyens désapprouvent le basculement vers la monnaie unique, contre seulement 43% qui pencheraient en sa faveur.
Une opposition qui n’a cessé de grimper depuis deux ans. Du fait des campagnes des forces pro-russes, accusent évidemment le pouvoir en place et Bruxelles… Quoiqu’il en soit, dans ce pays qui est l’un des plus pauvres de l’UE, le ressentiment est palpable. 600 000 signatures avaient été recueillies pour que soit organisé un référendum sur cette perspective. Et le mois de juin a été marqué par des manifestations anti-euro rassemblant des dizaines de milliers de participants.
Le Président de la République lui-même, Roumen Radev, s’était dit favorable à une telle consultation. Mais au Parlement, 170 députés (sur 240) ont refusé cette perspective. Le gouvernement du Premier ministre Rossen Jeliazkov a tenu à passer en force, arguant que le pays « doit achever son intégration européenne ».
Bref, pour Bruxelles comme au sein du pouvoir à Sofia, l’adoption de l’euro s’imposait puisque les critères la conditionnant étaient remplis : l’inflation, qui avait flambé en 2022, est retombée officiellement à 2,7% ; les déficits publics ne dépassent pas 3% du PIB, et la dette ne représente que 24% de ce dernier ; enfin, le taux de change par rapport à l’euro est stable depuis deux ans, et les taux des obligations d’Etat restent bas.
De son côté, le gouverneur de la banque centrale nationale s’est voulu rassurant sur l’état d’esprit populaire : « tous les nouveaux Etats membres ont adhéré avec plus ou moins le même taux de soutien. Et deux ou trois ans plus tard, le soutien dépasse presque partout 70 % ».
Outre que cette affirmation est discutable, elle fait l’impasse sur la situation sociale et politique du pays. Le niveau de vie y est très bas pour une large partie de la population, et il a en outre été entamé par une hausse des prix record qui avait atteint jusqu’à 15% à l’automne 2022.
La Bulgarie a connu pas moins de sept élections générales depuis 2021
Surtout, la Bulgarie a connu pas moins de… sept élections générales depuis 2021 – un probable record du monde. Cette instabilité n’est pas due au hasard, et est loin d’être réglée. Schématiquement, le pays voit s’affronter deux coalitions aussi atlantistes et économiquement libérales l’une que l’autre, mais antagonistes sur la manière de gouverner.
La première est dirigée par Boïko Borissov, chef du parti GERB (droite, pro-UE) et qui fut premier ministre de 2009 à 2013, de 2014 à 2017, puis de 2017 à mai 2021. A cette date il connut une lourde défaite électorale, conséquence d’immenses scandales de corruption révélés en 2019. Avec pour conséquence un long mouvement lors de l’été 2020 où la mobilisation, notamment des classes moyennes urbaines, fut forte contre son pouvoir, accusé de clientélisme, de détournement de fonds, voire de pratiques mafieuses.
Ce mouvement hétéroclite n’a cependant connu de traduction politique immédiate. Après les scrutins d’avril puis de juillet 2021 émergea finalement, lors du vote de novembre 2021 un mouvement, baptisé « Continuons le changement » (PP), qui, sous la direction de deux jeunes diplômés d’universités américaines, dont Kiril Petkov (formé à Harvard), arriva en tête et forma un gouvernement minoritaire qui dura jusqu’en août 2022.
Le tout jeune premier ministre promettait un euro-libéralisme tout aussi fidèle que son prédécesseur, mais s’engageait à éradiquer la corruption et l’autoritarisme de M. Borissov. Il promettait de ne jamais passer d’accord avec ce dernier, symbole de la « pourriture » politique. Son fragile gouvernement chuta finalement sur une motion de censure.
Les scrutins d’octobre 2022, et plus encore d’avril 2023 connurent une nouveauté, liée à la situation en Ukraine : la progression du parti Vazrazhdane (Renaissance), souvent qualifié de « pro-russe » ou d’« ultra-nationaliste » – des qualificatifs que son leader récuse. Kostadin Kostadinov se réclame plutôt de l’intérêt de la Bulgarie à ne pas être en guerre contre la Russie. Le grand frère slave fut un allié historique du pays, tant au sein du Pacte de Varsovie, dans la deuxième moitié du vingtième siècle, que pour se libérer du joug ottoman, à la fin du dix-neuvième.
Sur le plan économique et social, Renaissance réclame des nationalisations ainsi que des hausses des salaires et des retraites. Il plaide pour la sortie de l’UE et de l’OTAN. Renaissance faisait partie du groupe Identité et Démocratie au sein du parlement européen sortant, et s’était opposé à ce que l’AfD (classée en Allemagne à l’extrême droite) en soit exclue.
Depuis lors, la succession des scrutins s’explique par le refus de la coalition « anti-corruption » autour du PP, une alliance libérale-écolo, pro-business, de s’allier avec le GERB qui symbolise corruption et démagogie « populiste ». Et cela, alors même que les deux forces soutiennent l’une et l’autre l’intégration européenne.
Après les élections d’avril 2023, sous la pression discrète de Bruxelles, le PP et le GERB finirent par trouver un compromis : un gouvernement d’alliance qui devait être dirigé pendant neuf mois par le premier, puis pendant les neuf mois suivants par le second. En mars 2024, il fallut constater que la seconde phase, contrairement aux engagements pris, n’obtenait pas de majorité parlementaire. Après trois tentatives infructueuses pour désigner un premier ministre, le président de la République, convoquait finalement les électeurs pour le 9 juin 2024.
Ce scrutin ne trancha toujours pas, puisqu’il ancra la présence durable du parti Renaissance, ce qui empêche arithmétiquement l’une des deux forces pro-UE d’obtenir une majorité parlementaire. Dernier scrutin en date, celui d’octobre 2024 ne changea pas fondamentalement l’équation, si ce n’est qu’il confirma l’apparition d’un second mouvement « pro-russe » (« Grandeur », à 4% environ), dénoncé par Renaissance comme une candidature de diversion.
Finalement, un nouveau premier ministre, Rossen Jeliazkov, issu du GERB, dirige le pays depuis le 16 janvier 2025, mais sans majorité parlementaire. Le PP est retourné dans l’opposition. Mais ce dernier s’est bien gardé de mettre des bâtons dans les roues de l’actuel gouvernement dès lors que ce dernier faisait le forcing pour faire avaliser le passage à l’euro.
Dans ces conditions, rien n’indique que le pouvoir actuel soit à l’abri de mouvements sociaux si, comme il est probable, le passage à l’euro redonne de la vigueur aux poussées inflationnistes. D’autant que l’actuel chef de l’Etat, critique vis-à-vis des forces pro-UE, continue à disposer d’une solide popularité. Ce dernier, ancien général commandant de l’armée de l’air, s’était présenté en 2016 sans soutien d’un parti, mais il était considéré comme proche des socialistes, et comme « pro-russe ». Il l’avait emporté au second tour avec 59% des suffrages, puis s’était attiré une vraie sympathie populaire durant son premier mandat, au point d’être réélu en 2021 avec 67% des voix.
Abandonner sa monnaie nationale revient à se lier les mains
Si la crainte de la hausse des prix et de la baisse du pouvoir d’achat nourrit l’opposition d’une majorité de citoyens, notamment parmi les plus déshérités, la véritable dangerosité de l’euro est plus fondamentale. Il en va de la Bulgarie comme des vingt pays qui ont déjà sauté le pas (le dernier en date fut la Croatie, en 2023) : la disparition de la monnaie nationale constitue un handicap pour tout pays dont les électeurs choisiraient de rompre avec la logique libérale imposée par les traités européens.
Disposer de sa propre monnaie reste un atout majeur de souveraineté. L’abandonner au profit des banquiers centraux de Francfort revient à se lier les mains quant à la possibilité d’une logique économique radicalement dissidente.
Cependant, dans l’état de crise multifactorielle dans lequel l’UE se débat actuellement – politique économique et financière, perspectives budgétaires (cadre financier pluriannuel), droits de douane américains, élargissement, migration et asile (sur ce dernier point, la libre circulation dans l’espace Schengen, souvent présentée comme l’acquis communautaire majeur, est chaque jour remise davantage en cause) – nul ne saurait exclure une possible déflagration.
Quoi qu’il en soit, la « petite » Bulgarie (6,6 millions d’habitants) reste un point chaud pour la suite de crises à répétition.