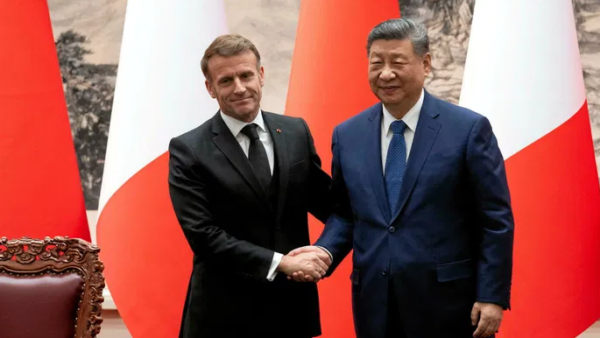Les 5 et 6 septembre s’est déroulé un grand colloque organisé par le ministère des Affaires étrangères, une initiative soutenue par l’Université de la Sorbonne nouvelle et accueillie par l’un de ses campus parisiens. Le public s’est pressé nombreux dans les différents forums, tables rondes et séminaires. Des centaines de participants étaient présents, notamment des jeunes tentés par une carrière diplomatique.
Le ministère avait mis les petits plats dans les grands pour attirer de futures vocations. Sous le titre général « La Fabrique de la Diplomatie », des dizaines de débats ont fait salle comble. En particulier ceux auxquels participaient des personnalités très médiatiques comme l’ancien premier ministre Dominique de Villepin (2005-2007), qui fut également à la tête du Quai d’Orsay (2002-2004) ; ou bien Gérard Araud, ancien ambassadeur de France en Israël, à l’ONU puis aux Etats-Unis.
Les intitulés des débats étaient conçus pour être alléchants. Parmi ceux-ci figuraient : « Le Sud global en quête d’un nouvel ordre international » ; « Proche-Orient : comment retrouver le chemin des négociations ? » ; « Diplomatie économique, entre Etats-Unis et Chine, quel espace pour l’Europe ? » ; « La présidence française du G7 en 2026 face aux grands déséquilibres mondiaux » ; « OTAN : une alliance parmi d’autres ? »…
C’est peu dire que la plupart des échanges entre participants aux différents panels étaient marqués par l’idéologie dominante. La nécessaire marche vers l’intégration européenne faisait évidemment partie des dogmes sacrés. Sans surprise, la russophobie se manifestait d’un débat à l’autre. Sa forme la plus récurrente était l’affirmation péremptoire selon laquelle, en substance, « Poutine ne cessera jamais ses guerres impériales si nous n’y mettons pas un coup d’arrêt ».
Pointant le risque que la population française manque d’enthousiasme pour s’engager dans une guerre contre Moscou le jour où la Russie attaquerait la Lituanie, un intervenant a fait applaudir avec enthousiasme la nécessité de combattre cette lâcheté… Un signe que les futures élites formant l’auditoire sont peu représentatives des sentiments populaires.
L’UE est incapable de réfléchir à une vision à long terme des rapports avec la Russie
Dans ce contexte, le discours quelque peu hétérodoxe de certaines personnalités tranchait sur l’ambiance générale et méritait donc attention. Ce fut notamment le cas dans le forum baptisé « Quelle architecture de sécurité européenne ? ». Le premier intervenant fut Hubert Védrine. Cet ancien ministre des Affaires étrangères (1997-2002) fait partie de l’école des « réalistes » (par opposition aux idéologues jusqu’au-boutistes), et cultive une parole qu’il veut non soumise à la pensée officielle du moment, même s’il reste un partisan de l’Alliance atlantique et voue le Kremlin aux gémonies.
Il a profité de l’occasion pour faire entendre sa différence, en contestant énergiquement qu’un « pilier européen » de l’OTAN soit en cours de construction. « Oubliez la communication officielle et la propagande, la ‘défense européenne’ est un concept refusé dans les faits par la plupart des pays de l’Alliance qui rêvent tous prioritairement de la protection de l’Oncle Sam », a martelé en substance M. Védrine. Selon lui, la France est isolée sur la ligne prônant la « souveraineté européenne » chère à Emmanuel Macron (comme en témoigne le récent sommet de La Haye). La plupart des Alliés continuent à acquérir majoritairement des armes et équipements américains, a insisté l’ancien chef du Quai d’Orsay.
Pierre Vimont a pour sa part tenu des propos plus hétérodoxes encore. L’homme n’a pourtant rien d’un « eurosceptique » : il exerça la fonction de secrétaire général du Service européen pour l’action extérieure après avoir été représentant permanent de la France auprès de l’UE. Bon connaisseur des arcanes bruxellois, il fut également directeur de cabinet de plusieurs ministres des Affaires étrangères, puis ambassadeur de France aux Etats-Unis.
Il personnifie l’image du diplomate traditionnel, « vieille école », cultivant l’analyse, la prudence, la nuance. Son propos n’en était que plus intéressant. Notamment lorsqu’il a pointé – pour la regretter – la grande difficulté de mener la réflexion au sein des Vingt-sept sur une architecture de sécurité en Europe. Pour cet acteur expérimenté, la plupart des Etats membres sont viscéralement rétifs à toute négociation diplomatique avec Moscou.
Pour certains d’entre eux, « c’est trop émotionnel » : ils refusent même l’hypothèse de débattre s’il y a un représentant russe présent. Conséquence : l’UE n’a pas de « politique russe » depuis l’élargissement de 2004. Pour illustrer son propos, le diplomate a rappelé qu’en 2021, la chancelière allemande avait proposé un sommet avec Moscou. Ce fut un véritable tollé, notamment des gouvernants de la plupart des pays de l’Est, et l’idée fut balayée.
Il n’est donc pas possible, a déploré l’orateur, ne serait-ce que de démarrer une réflexion stratégique dans ce domaine. L’UE est incapable de réfléchir à une vision à long terme des rapports avec la Russie. Indice supplémentaire : pour les contacts entre Russes et Occidentaux, les services de renseignement des deux parties tendent à supplanter les diplomates. Tout cela constitue une situation « dramatique », a-t-il regretté.
Hubert Védrine a rappelé l’« occasion historique manquée » lors de la disparition de l’URSS
Or, a insisté M. Vimont, il est plus nécessaire que jamais d’imaginer les relations avec Moscou dans l’avenir. Ce qui n’est pas la tâche des militaires, mais plutôt celle des diplomates, dont le métier consiste notamment à comprendre les interlocuteurs. Concernant la Russie, il faudrait donc s’intéresser aux « causes profondes » de la guerre actuelle vues par Moscou, notamment concernant ses propres garanties de sécurité.
Faute de quoi, selon lui, la situation va s’orienter vers un engagement militaire risqué, vers une instabilité stratégique chronique, mais aussi vers un danger d’éclatement de « l’unité européenne » (allusion à certains pays – Hongrie, Slovaquie…– tentés par un rapprochement avec Moscou).
Pour le diplomate, il faudrait définir le statut et la manière de gérer les pays d’une « zone grise » située entre l’UE et la Russie – zone à laquelle appartiennent par exemple la Géorgie, la Moldavie, et bien sûr l’Ukraine. Cela signifie-t-il de revenir aux accords d’Helsinki (1975) avec l’URSS ? Non, pense Pierre Vimont : on devrait plutôt réinventer un équilibre entre puissances, équilibre et compromis qui ne seraient pas sans rappeler quelques caractéristiques de la géopolitique du XIXème siècle.
Hubert Védrine a semblé opiner dans ce sens quand il a rappelé l’« occasion historique manquée » lors de la disparition de l’URSS, lorsque des géopolitologues américains de l’école réaliste (Henry Kissinger, John Mearsheimer,…) prônaient un compromis avec Moscou. Finalement, le président Clinton a balayé ces suggestions, considérant que l’Occident avait gagné la guerre froide, et qu’il lui revenait ainsi d’imposer unilatéralement sa domination.
Au terme de deux jours de colloque, la pensée euroatlantique est restée ultra-dominante. Les quelques voix réalistes n’en étaient que plus notables. Mais leur caractère très minoritaire laisse à penser que l’Union européenne est plus que jamais condamnée à une impasse.