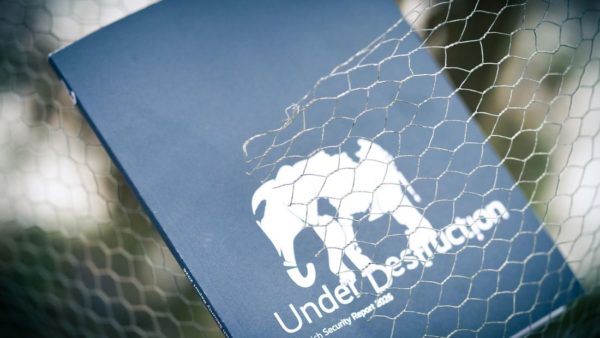Un dirigeant de premier plan a récemment a récemment appelé à « retrouver le goût du risque, de l’ambition et de la puissance ». Il serait intéressant de demander aux passants, dans une rue de Londres, Berlin ou Paris, de deviner l’auteur de cette exhortation. Il est fort probable que beaucoup d’entre eux l’attribueraient à Vladimir Poutine.
La phrase a en réalité été prononcée par Emmanuel Macron. Le président français, en visite à Lisbonne le 28 février, s’exprimait devant un forum d’entrepreneurs de la haute technologie. Mais son propos dépassait évidemment les simples considérations commerciales. Dans le contexte actuel, ses mots résonnaient étrangement, d’autant qu’il a exhorté l’Europe a être « fière de ce qu’elle est » et de son « processus de civilisation ». Et le chef de l’Etat de marteler : « on est un lieu en paix, mais on est un peu amorphe. On ne se projette pas suffisamment ».
Ce langage peut surprendre au moment où les grands médias occidentaux dépeignent le président russe en conquérant sans scrupule toujours à l’affût de nouvelles proies, en criminel rêvant de « rétablir l’empire soviétique » et piétinant pour ce faire toutes les règles internationales.
Par contraste, les dirigeants européens sont implicitement – ou explicitement – présentés comme humblement attachés à la stabilité et à la paix, seulement préoccupés de soutenir la veuve et l’orphelin, de calmer les ardeurs belliqueuses du Kremlin, et, au-delà, de réinventer un monde basé sur des règles justes et équitables.
La description irénique de l’UE ne colle pas vraiment à la réalité
Hélas, que l’on se tourne vers un passé lointain ou beaucoup plus récent, cette description irénique ne colle pas vraiment à la réalité. Pour ne pas remonter plus loin dans le temps, on peut rappeler que le 19ème siècle commença avec les nombreuses conquêtes napoléoniennes, qui ne furent pas franchement un exemple d’humanité et de tempérance. Puis, lors du Congrès de Vienne (1815), les différents empires se partagèrent la domination du Vieux Continent.
Ce même siècle fut également celui des conquêtes coloniales – un modèle de respect des droits de l’Homme… – donc de la soumission et du partage de l’Afrique mais aussi de la Chine, avec la Grande-Bretagne et la France comme actrices principales (mais pas exclusives).
Ces événements sont-ils suffisamment lointains pour qu’il y ait prescription ? Ce serait oublier que l’emprise coloniale dura jusqu’aux années 1950 et 1960. Ce n’est par exemple qu’en 1962 que l’Algérie conquit son indépendance, après une guerre – également conduite avec une grande humanité par les dirigeants français, comme l’on sait (photo) – qui, longtemps, n’avoua pas son nom.
Peut-être convient-il également de rappeler les détachements expéditionnaires des puissances européennes ouvertement envoyés, jusqu’au début des années 1920, pour tenter de tuer dans l’œuf la toute jeune Union soviétique.
Lors des décennies qui suivirent la seconde guerre mondiale, l’Oncle Sam s’érigea en chef de l’autoproclamé « monde libre »
De l’histoire ancienne ? Alors, il convient de s’intéresser aux décennies qui suivirent la seconde guerre mondiale, période où l’Oncle Sam s’érigea en chef de l’autoproclamé « monde libre » – une expression qui revient ces jours-ci à la mode. Entre 1945 et 1990, plusieurs dizaines de guerres et d’agressions, ouvertes ou dissimulées, furent alors lancées par ou avec Washington.
Parmi les plus connues figurent la guerre de Corée (1950-1953) et celle du Viêt-Nam (1964-1975, mais qui prit la suite d’une guerre française). Par le nombre des victimes – plusieurs millions – et l’ampleur des destructions, ces conflits restent des marqueurs incontestés de la douceur de la « civilisation occidentale ».
Mais il faudrait aussi citer le renversement du gouvernement de Mohammad Mossadegh en Iran (1953) ; celui du premier ministre guatémaltèque l’année suivante ; les bombardements de l’Indonésie (1958) puis l’aide à la répression (qui fit des millions de victimes) du mouvement démocratique dans ce pays (1965) ; la contribution au renversement de la démocratie brésilienne et à l’instauration de la dictature (1964) ; l’intervention au Panama cette même année, de même que dans la crise congolaise ; l’occupation de la République dominicaine (1965) ; l’extension de la guerre au Cambodge (1970) ; le soutien actif au général putschiste chilien Augusto Pinochet (1973) puis à la junte argentine (1976) ; l’armement et la promotion des moudjahiddines afghans (à partir de 1979) ; l’aide directe aux « escadrons de la mort » salvadoriens (1980-1990) ; celle aux « contras » nicaraguayens (1981-1988) ; l’invasion de la Grenade (1983) ; le bombardement (déjà) de la Libye (1986) ; l’invasion (encore) du Panama (1989) ; et l’ingérence directe aux Philippines cette même année. La liste n’est nullement exhaustive.
Cette liste se prolonge et s’amplifie à partir de l’effacement de l’URSS (1991). Les Etats-Unis et leurs alliés européens déclenchent la première guerre du Golfe cette année là. Parallèlement, ils interviennent en Somalie (1992). Et multiplient les bombardements sur l’Irak dans cette décennie. Par ailleurs, ils pilonnent et détruisent une grande usine de médicaments au Soudan (1998).
Les années 1990 sont aussi celles des guerres de Yougoslavie : en Bosnie-Herzégovine (1992-1995) puis en Serbie (1999). L’OTAN est à la manœuvre, avec un rôle militaire prépondérant de la puissance américaine, mais politiquement, c’est cette fois Berlin qui est à l’initiative. L’objectif est de faire éclater la Yougoslavie fédérative et non alignée pour mieux contrôler les Balkans émiettés en petits Etats.
Les années 2000 sont probablement plus fraîches dans les mémoires. Avec notamment l’invasion de l’Irak en 2003, qui fut précédée par un blocus provoquant la mort de centaines de milliers de personnes (parmi lesquelles entre 500 000 et 1 million d’enfants), dont la Secrétaire d’Etat américaine, Madeleine Albright, dira que c’était « difficile » mais que cela « en valait la peine ». A l’époque, Londres, Madrid et Lisbonne, ainsi que la plupart des pays de l’Est européen, participèrent à la guerre menée par George W. Bush. Guantanamo et Abou Ghraïb (où fut pratiquée la torture à l’échelle industrielle) resteront de parfaits symboles de l’attachement occidental aux droits de l’Homme.
Faut-il rappeler que ces faits d’armes se sont déroulés, pour la plupart d’entre eux, dans le déni le plus total du droit international ?
Cette litanie donne la mesure de l’humanité bienveillante dont se parent les dirigeants de l’Alliance atlantique…
La suite est connue : bombardement de la Libye par Paris et Londres ainsi que Washington « sur le siège arrière » (2011) avec pour conséquences l’abolition des structures étatiques dans ce pays, la prolifération des milices, et la libération sur la durée d’importants flux migratoires ; soutien multiforme aux forces désirant renverser le président syrien Bachar al-Assad (à partir de 2011), puis sanctions drastiques étranglant littéralement le pays. Au point de conduire, en décembre 2024, à l’arrivée au pouvoir à Damas d’un ancien d’Al-Quaïda.
Enfin, que dire du pays considéré comme la pointe avancée de l’Occident au Moyen-Orient, Israël ? Son premier ministre, après avoir mené une guerre ayant causé 50 000 victimes – en réalité bien plus – annonce vouloir resserrer encore le blocus pour priver d’eau potable les deux millions de Gazaouis, officiellement afin de punir le Hamas. A peine certains dirigeants européens froncent-ils un demi sourcil…
Cette litanie – très incomplète – donne la mesure de l’humanité bienveillante dont se parent les dirigeants de l’Alliance atlantique. L’OTAN, connue pour son pacifisme inné, « n’a jamais cherché à s’étendre », et si elle l’a fait, c’était « contre son gré » a même très sérieusement affirmé une journaliste française dans un documentaire diffusé tout récemment par la plus grande chaîne de télévision publique (France 2, 13/03/2025).
Nul n’est obligé de soutenir ou de partager la politique de Moscou. Et chacun, s’il le veut, peut applaudir les exploits occidentaux. Mais est-ce trop demander à ceux qui se rangent dans ce camp de nous épargner, au moins, leurs leçons de morale ?