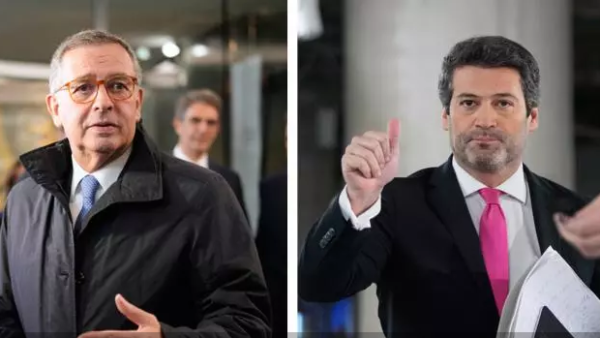Jamais, sans doute, les premières semaines du mandat d’un président américain n’auront provoqué une onde de choc aussi considérable dans le monde entier. Déclarations, décrets, provocations se succèdent à un rythme effréné : ambitions affichées sur le Panama, sur le Groenland, sur le Canada ; projets de « nettoyage » et prise de possession de Gaza ; quasi-fermeture de l’USAID ; droits de douane tous azimuts. Et cela ne pourrait bien être que le début.
L’Union européenne n’est pas épargnée. La plupart de ses dirigeants plongent dans la sidération, l’effroi, le désespoir. Chacun savait bien que l’hypothèse d’un retour de Donald Trump à la maison Blanche pouvait déclencher le chaos. Mais à ce point, aucun d’entre eux ne l’avait imaginé.
En France, en Allemagne et dans d’autres pays européens, les médias « mainstream » font chorus. Analyses d’experts, tribunes dans la presse écrite, « talk-shows » télévisés se multiplient. Avec notamment un refrain : comment le chef du monde occidental, notre grand frère, peut-il nous traiter aussi mal ? Avec autant de désinvolture ! Et ce – circonstance aggravante – au moment même ou l’Alliance atlantique devrait plus que jamais se serrer les coudes face à Moscou qui progresse sur le front ukrainien et menace le Vieux Continent. Un leitmotiv qui taraude les classes dirigeantes occidentales.
Dans cet océan apocalyptique, ces dernières semblent se raccrocher à une pensée magique : les mauvaises manières de Washington pourraient provoquer un sursaut en faveur de l’unité européenne, et relancer un processus d’intégration jusqu’à présent en panne, voire en régression. En réalité, pour l’heure, aucun signe concret en ce sens ne se dessine. Quelques capitales, comme Budapest ou Rome, voire Bratislava et peut-être bientôt Vienne et Prague, affichent au contraire une dissidence renforcée vis-à-vis de Bruxelles.
Mais la machine à propagande européenne s’est remise en marche à pleine puissance : face aux Etats-Unis sur qui il devient difficile de compter, voire qui s’apprêtent à faire preuve d’agressivité – en particulier commerciale – il deviendrait de plus en plus urgent de promouvoir une « souveraineté européenne », un oxymore promu depuis des années par Emmanuel Macron, et donc de renforcer l’intégration de l’UE.
Hasard du calendrier, cela tombe juste au cinquième anniversaire du Brexit. Ce qui a donné l’occasion aux commentateurs officiels de multiplier analyses et reportages censés montrer à quel point la situation économique du Royaume-Uni s’est dégradée – une contre-vérité si on la compare à de nombreux pays de l’Union européenne – et surtout à quel point les Britanniques regretteraient leur choix. Cette affirmation est particulièrement contestable, surtout si on se souvient que les instituts de sondage qui donnent cette indication sont ceux-là même qui avaient prévu une défaite du Brexit lors du référendum de juin 2016.
L’apparente évidence selon laquelle « ensemble, on est plus forts » est dangereuse et fausse
Quoiqu’il en soit, l’apparente évidence serinée depuis des décennies selon laquelle « ensemble, on est plus forts » revient en force dans la propagande pro-UE. La formule à l’apparence du bon sens. Elle est en réalité dangereuse et fausse.
Dangereuse parce qu’au nom de la puissance et de l’efficacité, elle fait l’impasse sur la liberté de chaque pays de décider de ses propres choix politiques. En effet, le principe même de l’intégration est de fixer un cadre de plus en plus étroit en dehors duquel toute décision est interdite.
Cela vaut sur le plan économique : le libéralisme, le marché et la concurrence doivent rester la règle ; cela vaut aussi pour le commerce international (Bruxelles à le monopole des accords commerciaux avec des pays tiers) ; également pour la monnaie (la BCE est « indépendante » et décide seule de la politique monétaire) ; on pourrait de même évoquer la politique fiscale, la politique migratoire.
Certes, plusieurs de ces cadres sont en train d’imploser sous la pression des contradictions objectives entre Etats membres. Mais les règles, et les sanctions, demeurent.
Pour autant, certains pourraient soutenir que l’efficacité et de la puissance collective valent bien, après tout, le sacrifice de la souveraineté nationale, autrement dit la liberté pour chaque peuple de choisir les orientations qu’il préfère. C’est la situation qui prévaut déjà depuis des années : en France notamment, les électeurs votent, les majorités se succèdent, alternent, voire disparaissent, et les grands choix restent analogues à des détails près. Ce qui aboutit à une crise majeure de la démocratie.
Mais est-ce au moins efficace ? Le moins qu’on puisse dire est que les résultats ne plaident pas en ce sens. Après plusieurs décennies de monnaie unique, de pacte de stabilité, de gouvernance économique commune, de surveillance budgétaire bruxelloise, et de « réformes structurelles » tournées contre les conquêtes sociales (marché du travail, retraites…), l’Union européenne est une des zones du monde où la croissance est la plus catastrophique, et où l’industrie se délite. Au point que ses dirigeants eux-mêmes agitent le spectre d’une lente agonie.
Dans un autre domaine, la déréglementation imposée à tous les Etats membres a introduit la concurrence dans les services publics notamment dans les Télécoms, les transports ferroviaires, l’énergie… Dans ce dernier domaine en particulier, les dégâts sont immenses, et les usagers en paient la facture.
Par ailleurs, les mouvements de révolte parmi les agriculteurs de différents pays qu’a suscités la signature récente du traité de libre échange avec le Mercosur illustrent à quel point le pouvoir exclusif de négociation dont dispose la Commission européenne est néfaste.
En réalité, les intérêts (de même que les configurations économiques et les cultures politiques) des différents Etats sont divers, parfois même divergents ou contradictoires. Vouloir faire rentrer « tout le monde dans le même moule » se fait nécessairement au détriment du plus grand nombre. L’union ne fait pas la force, mais la faiblesse.
Il y a à cet égard un contre-exemple parfait : la Suisse. Ce petit pays a jusqu’à présent refusé d’adhérer à l’UE (malgré les efforts d’une partie de sa classe dirigeante et de Bruxelles) et défend sa souveraineté. Ses performances économiques ont de quoi faire pâlir d’envie la plupart de ses voisins. La préservation de sa liberté de manœuvre y contribue sans doute pour beaucoup.
Une liberté de manœuvre qui vaut aussi en diplomatie – là où le cadre européen handicape la mise en œuvre de politiques étrangères nationales indépendantes. Du reste, les Vingt-sept n’ont même pas pu adopter une position commune face aux provocations du président Trump sur le sort des Palestiniens.
Le problème n’est pas cette incapacité communautaire, mais l’interdiction que tel ou tel pays s’engage dans une voie originale. Paris serait ainsi dans l’impossibilité de renouer avec « la politique arabe de la France » qui pointait la responsabilité écrasante d’Israël, et qui fut lancée sous la présidence du Général de Gaulle, puis abandonnée depuis bien longtemps.
Les prochaines semaines devraient confirmer à quel point il est peu probable que l’UE trouve la voie de l’unité. Mais il n’est jamais inutile de rappeler à quels dégâts supplémentaires pourrait conduire cette hypothétique unité…