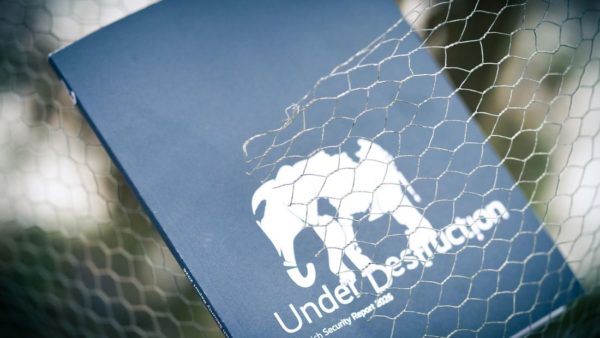Souvent, les Conseils européens sont avant tout une affaire de mise en scène. Réunis le 6 mars à Bruxelles, les vingt-sept chefs d’Etat et de gouvernement – du moins la plupart d’entre eux – avaient comme objectif d’afficher une apparence d’unité. Deux points – inséparables – constituaient leur ordre du jour : le « réarmement de l’Europe » ; et l’amplification du soutien à Kiev.
Cette image d’unité avait déjà été la première préoccupation à Bruxelles en février 2022, lorsque les troupes russes avaient pénétré en Ukraine. Mais entre temps, le paysage s’est radicalement transformé, en particulier depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. En à peine quelques semaines, les pires cauchemars des dirigeants européens sont devenus réalité.
Washington a d’abord confirmé qu’il excluait toute présence de troupes américaine en Ukraine, ainsi que toute perspective d’adhésion de ce pays à l’OTAN. Peu après, le vice-président des Etats-Unis a, de Munich, asséné à un auditoire sidéré que la menace « sur nos valeurs » ne venait ni de Moscou, ni de Pékin, mais d’Europe – notamment en matière de liberté d’expression. La diplomatie américaine votait, dix jours plus tard, avec les Russes, contre une résolution onusienne soutenue par les Européens (sauf la Hongrie) condamnant Moscou.
Entre temps, la rencontre à haut niveau, à Riyad, entre Russes et Américains fit comprendre aux Européens qu’ils n’auraient même pas un strapontin lorsque des négociations de paix s’engageraient. Le président Trump a ensuite estimé que son homologue ukrainien était un dictateur et qu’il portait la responsabilité du déclenchement du conflit.
Quelques jours plus tard, Volodymyr Zelensky était publiquement humilié, dans le bureau Ovale de la Maison Blanche, dans une scène qui fit le tour du monde et qui constitua une première dans les annales diplomatiques : MM. Trump et Vance l’ont accusé de jouer avec la perspective d’une troisième guerre mondiale, et lui ont fait comprendre que la défaite de Kiev était la seule perspective si les dirigeants ukrainiens ne se soumettaient pas aux exigences américaines.
Et pour confirmer le propos, Washington suspendait dans la foulée toute aide militaire et financière à Kiev, et même jusqu’à la fourniture des renseignements sur la situation du front – un ultime coup dur pour l’armée ukrainienne. Ensuite, l’aide fut rétablie après que les négociateurs américains eurent obtenu que l’Ukraine accepte le principe d’un cessez-le-feu temporaire sans les « garanties de sécurité » que cette dernière exigeait. Moscou attend des détails de la part Etats-Unis avant de se prononcer.
Quoiqu’il en soit, les leaders occidentaux, totalement désorientés, ont qualifié tout cela de « trahison » américaine et de « retournement d’alliance ». Quant à la perspective que l’Union européenne compense la disparition du soutien américain à Kiev, elle est vite apparue irréaliste. L’UE et ses Etats membres ont versé 135,4 milliards d’euros depuis 2022, dont 49,2 milliards d’euros de soutien militaire, et ont déjà prévu de monter les enchères de 30 milliards cette année.
Dans cette agitation proche de la panique, le président français a convoqué le 17 février un mini sommet avec quelques dirigeants « importants » des pays de l’UE. Ce qui a provoqué des crispations notamment de ceux qui n’avaient pas été conviés (République tchèque, Roumanie…). Une réunion de rattrapage a été organisée le surlendemain dans une nouvelle configuration intégrant des pays hors UE, qui n’a nullement calmé les frustrations.
Une nouvelle rencontre s’est déroulée le 2 mars à Londres, cette fois à l’initiative du Royaume-Uni – pays hors UE – avec le Canada et la Turquie, ce qui a rajouté à la confusion. Et confirmé ce que certains dirigeants et experts européens pressentaient : en matière de défense, l’Union européenne ne peut être un cadre valide.
D’autant qu’en son sein, Budapest s’affiche plus proche des analyses de Washington et de Moscou que de Bruxelles. A mi-voix, c’est aussi le cas de la Slovaquie. Et l’Italienne Giorgia Meloni ne cesse de cultiver sa relation privilégiée avec l’administration Trump. Enfin, des élections ont lieu cette année en Roumanie et en République tchèque qui pourraient faire basculer ces pays vers les positions de Budapest. Le premier ministre Viktor Orban ne cesse d’affirmer « il n’y a pas de solution sur le champ de bataille », ce qui exaspère ses homologues.
C’est donc dans ce contexte que s’est tenu le Conseil européen du 6 mars. Ce dernier a, comme premier point, entériné le plan présenté l’avant-veille par la présidente de la Commission européenne intitulé « Réarmer l’Europe ».
… La suite de l’article est réservée aux abonnés…