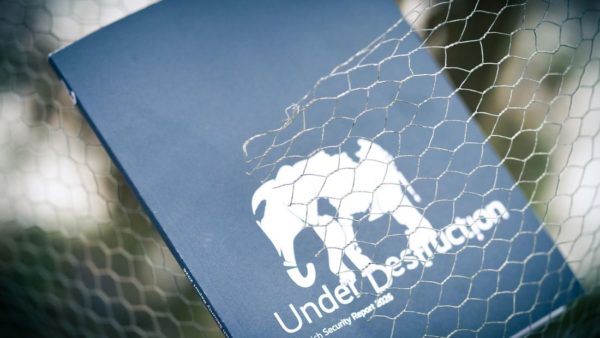Les sommets européens se suivent et se ressemblent. Mêmes acteurs, même scénario, mêmes dialogues, mêmes querelles, mêmes résultats, ou, le cas échéant, mêmes impasses. Le Conseil européen du 23 octobre, qui a réuni les vingt-sept chefs d’Etat et de gouvernement à Bruxelles, n’a pas dérogé à ce sentiment du même film éternellement recommencé. Il se tenait ainsi après une réunion informelle des mêmes le 3 octobre à Copenhague.
Il s’agissait cette fois d’une réunion ordinaire. Les sujets récurrents étaient donc à l’ordre du jour, comme par exemple les migrations, et bien sûr l’éternel thème de la « compétitivité » qui a donné lieu à de longs développements dans les conclusions publiées.
Dans l’inimitable jargon communautaire, on peut ainsi lire : « le Conseil européen a tenu un débat approfondi sur la manière de renforcer encore la compétitivité de l’UE (…) en mettant l’accent sur la simplification, une transition écologique compétitive et une transition numérique souveraine ».
En langage plus simple, les Vingt-sept sont pris en étau entre les engagements du « Pacte vert » décidés à l’initiative de la Commission entre 2019 et 2024, la concurrence renforcée de la Chine, et l’agressivité commerciale des Etats-Unis. L’Union européenne, qui se vantait jadis de devenir « l’économie la plus compétitive du monde », est devenue la zone où la croissance est la plus catastrophique des cinq continents.
Sans surprise cependant, ce sont les dossiers de l’aide à l’Ukraine et du renforcement militaire européen qui ont été les plus médiatisés. Depuis le début de la guerre, « l’Union européenne et ses États membres ont fourni 177,5 milliards d’euros pour venir en aide à l’Ukraine et à sa population » rappellent les Vingt-sept, qui poursuivent : « le Conseil européen s’engage à répondre aux besoins financiers urgents de l’Ukraine pour la période 2026-2027, y compris pour ce qui est de ses efforts militaires et de défense ».
Les sommes débloquées par l’UE pour l’Ukraine ces dernières années seront épuisées début 2026
Sauf que, désormais, les fonds viennent à manquer. Les sommes débloquées par l’UE ces dernières années seront épuisées début 2026. Et la plupart des Etats membres n’ont pas de marges de manœuvre budgétaires nationales pour remettre au pot – c’est particulièrement le cas de la France, où le gouvernement fragilisé espère que les débats parlementaires actuels aboutiront à des coupes budgétaires majeures.
Dans ces conditions, l’idée fait son chemin depuis des mois dans les sphères bruxelloises : utiliser les avoirs russes que l’UE a décidé de bloquer en 2022. Jusqu’à présent, les dirigeants européens ne s’étaient pas gênés pour s’approprier les intérêts produits par les 170 milliards que Moscou avait placés dans l’institution financière de droit belge Euroclear.
Certains Etats membres plaidaient pour aller plus loin en mettant la main sur le capital. Mais cet acte s’apparenterait à un vol pur et simple. Ce ne sont certes pas les scrupules moraux qui retiennent les dirigeants européens. Mais beaucoup de ces derniers, de même que la Banque centrale européenne, ont mis en garde face à un double risque : juridique, car une instance internationale d’arbitrage pourrait casser cette décision et sommer l’UE de rembourser et de payer des dommages ; et financier, face aux réactions des investisseurs internationaux, potentiellement effrayés par une telle jurisprudence banalisant l’expropriation.
C’est dans ce contexte que la Commission européenne travaillait à un schéma visant à contourner cette difficulté, comme l’avait annoncé sa présidente lors de son discours de septembre. Bruxelles a donc proposé un montage complexe : l’UE emprunterait 140 milliards à la société belge Euroclear où sont logés les actifs russes ; cette somme serait ensuite fournie à Kiev par tranches au cours des années 2026 et 2027 sous forme de prêt à taux zéro ; et remboursée par l’Ukraine lorsque celle-ci aurait reçu les dommages de guerre que Moscou lui verserait.
Et si cette dernière hypothèse ne se réalisait pas – en réalité, la Russie ne paiera certainement jamais un seul kopek – Bruxelles se dédommagerait en s’appropriant les avoirs russes. Cette proposition avait déjà vu s’affronter les dirigeants européens le 3 octobre. Le président du Conseil, le Portugais Antonio Costa, avait alors remis le sujet à la réunion du 23, se disant convaincu qu’une amélioration serait trouvée.
La Slovaquie et la Hongrie restaient peu enthousiastes, ce qui constituait un problème dans la mesure où le maintien du gel des fonds nécessite un vote unanime tous les six mois pour renouveler les sanctions contre Moscou. A supposer que ce gel ne soit pas prolongé, tout le schéma bruxellois s’effondre.
Mais c’est finalement la Belgique qui a fait capoter – pour l’instant – le montage de Bruxelles. Son premier ministre, Bart de Wever, a en effet fait valoir que son pays serait en première ligne si Moscou prenait des mesures de rétorsion ou gagnait un recours juridique.
M. de Wever a donc exigé une mutualisation totale du risque en martelant : « imaginez s’il faut rembourser 180 milliards, ce serait une folie totale ». Il a même averti : « je cherche la base juridique de cette décision. Même pendant la seconde guerre mondiale, les actifs immobilisés n’ont jamais été touchés ».
Il n’était pas tout seul à s’interroger. Le chancelier allemand, pourtant en principe enthousiaste pour sanctionner Moscou, a concédé : « si j’étais premier ministre belge, je soulèverais les mêmes questions ».
Les conclusions initiales du sommet, qui devaient acter le schéma proposé par Ursula von der Leyen, ont donc dû être amendées pour acter l’échec des discussions : les Vingt-sept « invitent la Commission et le Conseil à faire avancer les travaux, afin que le Conseil européen revienne sur cette question lors de sa prochaine réunion ». Celle-ci se tiendra en décembre.
Les dirigeants européens finissent par se convaincre les uns les autres de leur propre propagande
Invité au sommet, le président ukrainien n’a pas caché sa grande déception. Il avait au préalable rappelé à ses hôtes : « nous avons besoin d’argent en 2026, ce serait mieux d’en avoir au début de l’année prochaine ».
Il a tenté de se consoler avec l’annonce du dix-neuvième « paquet de sanctions » contre la Russie, que le Conseil européen a avalisé, sans que la Hongrie ou la Slovaquie, qui avaient mis en garde contre les conséquences de nouvelles sanctions, n’y mettent leur veto. Parmi les mesures annoncées figure la fin de l’achat de gaz russe par les pays de l’UE.
La veille, le président américain avait pris des mesures punitives contre deux géants pétroliers russes, Rosneft et Lukoil. Emmanuel Macron s’est réjoui de cette concomitance, en estimant qu’il s’agissait d’un « véritable tournant ». En réalité, même si les rétorsions gênent l’économie russe, nul n’imagine qu’elles inversent le cours des événements – pas plus que les dix-huit paquets précédents.
Enfin, le Conseil a consacré une large part de ses travaux à « la défense et la sécurité européennes », autrement dit à l’accélération de la militarisation des Etats membres. Avec notamment la référence à « la feuille de route sur la préparation de la défense européenne à l’horizon 2030 » proposée par la Commission le 16 octobre. Là encore, il s’agit d’un sujet qui rebondit d’un sommet au suivant.
Conséquence : les dirigeants européens finissent par se convaincre les uns les autres de leur propre propagande, et notamment de la perspective d’une invasion russe de l’Europe dans les années qui viennent.
Dernier exemple en date : le chef d’Etat-major français, reflétant évidemment la ligne de l’Elysée, a déclaré le 22 octobre vouloir que les armées « se tiennent prêtes à un choc, dans trois ou quatre ans », autrement dit à une guerre ouverte contre la Russie.
Les dirigeants européens sont certes empêtrés dans leurs querelles internes. Cela ne les empêche pas de faire des prophéties funestes, avec le risque immense que celles-ci deviennent un jour auto-réalisatrices.