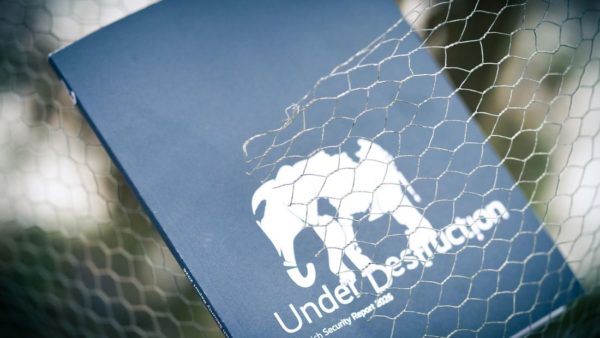Il a récidivé. Intervenant le 18 novembre devant le congrès des maires de France, le chef d’Etat major des armées françaises a manifestement voulu provoquer – et ses propos, en effet, ne sont pas passés inaperçus. Le 22 octobre déjà, il affirmait devant les parlementaires que les militaires devaient se préparer, « d’ici à trois ou quatre ans (…) à un choc frontal » contre la Russie.
Un mois plus tard donc, il précisait sa pensée : « on a tout (…) pour dissuader le régime de Moscou (sic) d’essayer de tenter sa chance plus loin. Ce qui nous manque, c’est la force d’âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l’on est ». Et le général Fabien Mandon de marteler : « si notre pays flanche, parce qu’il n’est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, de souffrir économiquement, parce que les priorités iront à de la production de défense par exemple, si on n’est pas prêt à ça, alors on est en risque ».
L’état d’esprit n’est pas vraiment nouveau. Déjà, lorsqu’il avait pris ses fonctions, l’été dernier, son prédécesseur qui lui passait le relais s’était exprimé dans la même tonalité. Nommé directement par le président de la République, et connu pour être très proche de celui-ci (il était précédemment son chef d’Etat-major particulier), le militaire le plus haut gradé n’a évidemment pas pris la parole sans en référer à Emmanuel Macron.
Il était même probablement en mission. Sinon, un esprit un peu naïf pourrait s’interroger : si vraiment le pays était à la veille d’attaques majeures des troupes russes, le chef des armées de terre, de l’air et de la marine n’avait-il pas plus urgent à faire que de discourir devant les maires de France ?
Le général Mandon a du reste ingénument confirmé la nature de sa mission en interpellant les élus locaux : « il faut en parler dans vos communes ». Les maires passent en effet pour les seuls élus qui gardent une crédibilité de la part de leurs concitoyens. Le lieu choisi relève donc d’une préoccupation majeure : créer un choc de communication que le maître de l’Elysée, complètement discrédité, n’est plus en mesure de provoquer.
Le message est simple : la Russie est notre ennemie ; elle se prépare à attaquer l’Europe dès qu’elle en aura fini avec l’Ukraine
Le message est simple à résumer : la Russie est notre ennemie ; elle se prépare à attaquer l’Europe dès qu’elle en aura fini avec l’Ukraine, « notre dernier rempart ». Mais il manque au dit message un fondement crédible et rationnel. Cela fait certes des mois, en réalité des années, qu’il constitue le fil rouge du discours des dirigeants européens ; mais, pour l’heure, sans convaincre les peuples – pas plus en Allemagne, en Italie ou en Espagne qu’en France – de faire des sacrifices pour Kiev (encore moins au moment où sont révélés d’énormes scandales de corruption impliquant le premier cercle du président ukrainien).
Du reste, la montée en puissance du discours alarmiste et belliciste n’est pas une exclusivité française. Le 19 novembre, le commandant en chef de l’armée suédoise se disait ainsi convaincu que la Russie est prête « à prendre d’énormes risques stratégiques pour obtenir tout ce qu’elle juge possible ».
La veille – c’est-à-dire le même jour que la communication du général Mandon – son homologue polonais considérait que son pays se trouvait dans une phase « d’avant-guerre ». Déjà en février dernier, leur collègue allemand dépeignait la Russie en « menace imminente »… Et son ministre de tutelle, Boris Pistorius, relayait des évaluations de stratèges selon lesquelles « nous venons de connaître notre dernier été de paix »…
La responsabilité de la surenchère est à chercher en amont, au sein du Conseil européen
Reste une question essentielle : quoi qu’on pense de la guerre actuelle, comment les dirigeants européens en sont-ils arrivés à un tel degré d’hystérie ? Si les facteurs sont multiples, il faut cependant pointer la responsabilité écrasante de l’Union européenne.
Certes, il y a un énorme décalage entre d’une part les discours appelant à la mise en place d’une « défense » commune et d’outils militaires intégrés, et d’autre part la modestie des « avancées » réelles dans ce domaine, au grand désespoir de la Commission européenne.
La politique extérieure commune est également en échec, comme en témoignent les différents « formats » qui se multiplient : E3 (Paris, Berlin, Londres), « triangle de Weimar » (Paris, Berlin, Varsovie), « Weimar + » (les mêmes, plus Madrid et Rome), « coalition des volontaires » (incluant le Royaume-Uni, la Norvège, le Canada…). La seule configuration au point mort est… l’UE à vingt-sept, tant les querelles internes sont sous-jacentes, sans compter les rivalités qui viennent d’apparaître au grand jour entre la Commission européenne et le Service européen d’action extérieure.
En revanche, la responsabilité de la surenchère est à chercher en amont, en l’occurrence au sein du Conseil européen. Les chefs d’Etat et de gouvernement s’y retrouvent régulièrement, et la plupart d’entre eux y ont créé – parfois depuis des années – une familiarité : on s’y tutoie, on s’embrasse chaleureusement, on s’y fait la bise.
Dans ce climat, les échanges sont propices à la surenchère, et, sauf exception (Viktor Orban, notamment), chacun trouverait malvenu de troubler l’ambiance en apportant la contradiction sur le sujet ukrainien en particulier ; ou même en faisant valoir des nuances de peur d’être regardé comme un « mou ».
Cette configuration a beaucoup contribué à ce que l’extrémisme belliciste de la Pologne ou des Baltes soit devenu la norme parmi les Vingt-sept. Et à force (notamment) de fréquenter ce cénacle et de multiplier les échanges sur un ton radical vis-à-vis de Moscou, les dirigeants finissent par se convaincre mutuellement que leur propagande de guerre reflète la réalité. Par s’auto-intoxiquer, en quelque sorte. Cet éclairage relève certes de la psychologie, il n’en reflète pas moins une part de la réalité des évolutions politiques collectives.
A jouer avec le feu, on prend le risque de dérapages qui pourraient un jour devenir hors de contrôle
Pourquoi ces dernières se sont-elles tout récemment accélérées, comme l’illustre l’intervention du général Mandon ? Sans doute la situation militaire de plus en plus délicate de l’Ukraine constitue-t-elle une part de l’explication. A cela, il faut ajouter la publication du « plan Trump » (dont les chancelleries ne pouvaient ignorer la préparation discrète à Washington) considéré comme équivalant à une « capitulation » de Kiev par les dirigeants européens.
Dès lors, ces derniers se radicalisent-ils par dépit d’avoir été tenus à l’écart d’un plan exactement aux antipodes de la défaite de la Russie, ce qu’ils visaient depuis 2022 ? Certains d’entre eux rêvent-ils au « coup d’après », quand le mandat de l’actuel président américain sera arrivé à son terme, échéance après laquelle ils se verraient bien contribuer militairement à une revanche territoriale et politique ukrainienne ?
Si tel était le cas, cette rêverie serait illusoire. Mais particulièrement dangereuse, tant il est vrai qu’à jouer avec le feu, on prend le risque de dérapages qui pourraient un jour devenir hors de contrôle.